Lancé au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, le programme de recherche "13-Novembre" explore depuis dix ans le choc que l'événement a provoqué individuellement et collectivement. Il a permis des avancées importantes dans la compréhension des mécanismes du Trouble de stress post-traumatique.

Programme 13-Novembre : 10 ans de recherches pour dépasser le traumatisme
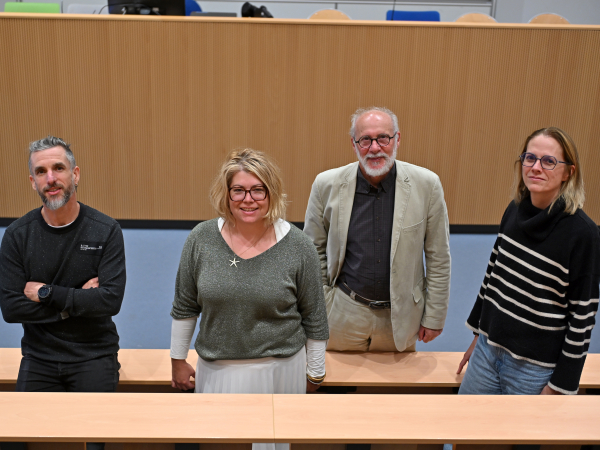
Le 13 novembre 2015 est dans toutes les mémoires : ce soir-là, plusieurs attaques-suicides et fusillades ciblent les abords du Stade de France à Saint-Denis, des terrasses de cafés des 10e et 11e arrondissements de Paris, et la salle de spectacle du Bataclan.
Revendiqués par l’organisation État islamique (aussi appelée Daech), ces attentats font 130 victimes et plus de 400 blessés.
Opposer à la terreur la recherche et la science
"Comme tout le monde, j’ai d’abord été sous le choc et la sidération de ces terribles événements, se souvient le professeur Francis Eustache, neuropsychologue caennais. Dans les jours qui ont suivi, avec Denis Peschanski, nous nous sommes demandés comment nous pouvions répondre à ces actes terroristes avec nos armes, celles de la recherche et de la connaissance, en agissant dans notre domaine : les études sur la mémoire des événements traumatiques. »
Ensemble, ils définissent le programme de recherche transdisciplinaire "13-Novembre", dont ils sont co-responsables. Il s'agit d'étudier sur douze ans la construction et l'évolution des mémoires, à la fois individuelles et collectives, des attentats du 13 novembre 2015.
L'ossature du projet, dénommée étude-1000, repose sur le recueil scientifique de témoignages de près d'un millier de volontaires :
- rescapés,
- proches des victimes,
- membres des équipes de secours et des forces de l’ordre intervenues sur place.
1 000 entretiens menés à Paris, Caen, Metz et Montpellier
"Malgré son ampleur inédite, le projet s'est concrétisé assez vite, précise Francis Eustache. Il a bénéficié d'une symbiose exceptionnelle entre les décideurs politiques et scientifiques et les associations de victimes. C'est un engagement qui dépasse le cadre de la recherche. À Caen, les premiers entretiens ont pu être menés dès le printemps 2016. Chaque cas est unique et particulièrement sensible."
Les témoignages, collectés en plusieurs campagnes successives, permettent d'évaluer et de mieux comprendre :
- la persistance des souvenirs,
- les effets du traumatisme,
- et les processus de résilience à l'œuvre.
Ces données font l'objet d'analyses de la part d'équipes de recherche en neurosciences comme en différentes sciences humaines et sociales. À ce jour, le programme "13-Novembre" a initié 28 doctorats, dont 14 ont déjà été soutenus.
Un traumatisme bouleverse le récit de vie que chacun se construit
"Notre mémoire, qui se constitue de nos expériences de vie, fonde notre identité, définit Peggy Quinette, maître de conférences à l'Université. Elle oriente notre façon d'agir et notre vision du futur. Un événement traumatique vient bouleverser le récit de vie cohérent que chacun se construit. L'étude-1000 permet notamment d'observer dans la durée comment les personnes parviennent ou non à réattribuer du sens à l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue."
Les avancées de Remember
En parallèle de l'étude-1000, le programme Remember dirigé par le chercheur en neurosciences, Pierre Gagnepain, est principalement mené à Cyceron, plateforme d'imagerie biomédicale de Caen. Pour mieux comprendre les effets d'un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau, l'étude porte depuis 2016 sur 200 volontaires :
- 120 personnes directement exposées aux attentats,
- et 80 non-exposées.
Un message porteur d'espoir
"Nous avons fait des avancées importantes sur la compréhension du Trouble de stress post-traumatique (TSPT), qui se caractérise par la reviviscence involontaire d'images intrusives extrêmement stressantes", explique Pierre Gagnepain.
La première découverte concerne le fonctionnement des mécanismes de contrôle de la mémoire qui permettent normalement de bloquer ces images intrusives, et qui se trouvent dégradés chez les personnes souffrant de TSPT.
"Le suivi sur le long terme des volontaires nous a permis de mettre en évidence la plasticité de ces mécanismes de contrôle, qui se remettent à fonctionner normalement chez les personnes parvenant à se remettre de leur TSPT. C'est un résultat qui constitue un message porteur d'espoir pour les personnes atteintes de troubles de stress post-traumatique : leurs symptômes ne sont pas irréversibles".
Il ouvre également des perspectives de nouveaux protocoles de soins. "Ces protocoles pourraient s'articuler autour de ces mécanismes de contrôle et n'auraient pas besoin de faire appel à la mémoire traumatique des patients."
Date de publication: 13/11/2025
Dernière mise à jour de la page: 24/12/2025 à 10h20







